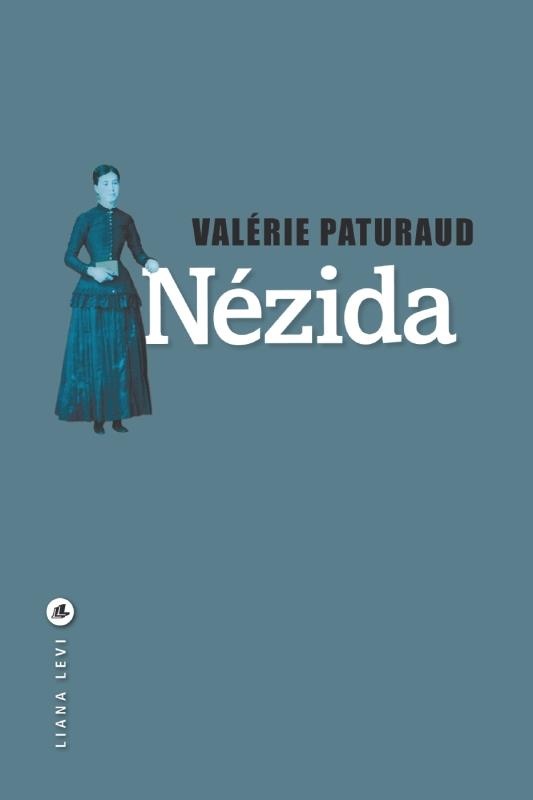Nézida
Septembre 1884. Nézida est revenue à la Calade, dans ce hameau perché au-dessus de la vallée de Dieulefit, aux confins de la Provence et du Dauphiné. Elle vient d'accoucher de son premier enfant, une fille. La vie aurait dû s'épanouir, elle la quitte, et la mort menace déjà l'enfant dans les langes. La bise noire souffle sur ce coin de terre aride où s'accrochent depuis des siècles des familles de paysans et de manufacturiers protestants. Dans le silence épais des dernières heures, autour de la jeune femme très faible, se mettent à se souvenir et à parler tous ceux qui l'ont aimée, qui l'ont connue, sa mère, ses frères, sa belle-mère, les Soubeyran, Antonin son mari, son instituteur, et ses deux amies.
À tous elle a imprimé la marque de la liberté, de la passion et de l'indépendance. Elle avait réussi à s'instruire et à enseigner, à quitter la ferme et ses travaux, elle avait attendu l'homme qui lui plaisait pour se marier, et choisi de vivre à la ville. Elle savait enfin qu'elle s'inscrirait dans une école pour devenir l'une des premières infirmières.
Rien n'aurait dû l'arrêter dans son émancipation. Nézida est l'histoire de la jeune femme au prénom unique, née Cordeil, épouse Soubeyran. Elle a existé. Valérie Paturaud a retrouvé sa trace ténue, presque effacée, dans des archives familiales. Le roman toujours répare l'oubli, et l'injustice de l'oubli.
Valérie Paturaud a exercé le métier d’institutrice dans les quartiers difficiles des cités de l’Essonne après avoir travaillé à la Protection judiciaire de la jeunesse. Installée depuis plusieurs années à Dieulefit, elle s’intéresse à l’histoire culturelle de la vallée, haut lieu du protestantisme et de la Résistance. Avec ce premier roman, elle signe un récit polyphonique intense et émouvant.
Extrait
Silence.
Silence dans la maison. Pénombre et silence, les volets sont presque clos et impriment leur ombre de craie grise sur les murs qui soutiennent encore ce qui reste de vie. La bise noire s’insinue déjà en cette fin septembre. Un vent glacial et puissant venu du nord étouffe de ses voiles sombres les collines et balaie de mauve la terre. Il malmène les âmes comme les bêtes. Les légendes courent... Les hommes deviendraient fous, les femmes hystériques, les crimes commis ces jours de grand vent seraient amnistiés.
Le loquet du volet s’agite par bourrasques ; son battement ponctue l’absence de mouvement dans la pièce sombre. Quelques pommes sur la table, un reste de pain, le couteau, la cruche d’eau.
La tête penchée, le corps maigre mais si lourd, tout le corps vers l’avant, Paul Cordeil pousse de ses doigts une mie de pain, l’éloigne, la reprend, concentré sur cette action infime. Le temps et le silence s’étirent. Il lève un peu la tête, regarde l’horloge. L’aiguille s’est à peine déplacée depuis son dernier coup d’œil. La mie de pain occupe son esprit, le silence est tel qu’il se croit seul.
Près de la cheminée pourtant, une ombre de laine se déplace lentement, attentive à sa tâche. Au gré de ses gestes, lumière et obscurité varient dans la pièce immobile. Elle s’applique à remplir d’eau bouillante la cuvette émaillée, d’un geste sûr, de la marmite à la cuvette. Très lentement, elle se dirige vers l’escalier de bois. Elle passe devant Paul. Il ne s’interrompt pas, ne lève pas la tête. La première marche craque un peu. Ouvrir la porte sans pencher le récipient. Ne pas renverser.
Il fait encore plus sombre dans la chambre où les persiennes sont tirées, protégeant les vitres des assauts du vent. La chambre est simple: une commode sur laquelle la photo d’un soldat fait face au portrait de jeunes mariés. Une couronne sous un globe ovale: petites fleurs blanches, minuscules pétales liés par une fine tige de perles.
Deux chaises de bois clair.
Et le lit en fer.
Des draps blancs tout juste sortis de l’imposante armoire.
Fine, transparente, dans une chemise de nuit boutonnée très haut, le col humide, paupières baissées, longues mains teintées de bleu posées sur les draps amidonnés, un mouchoir de dentelle sur l’oreiller, Nézida dort calmement, désespérément... le souffle imperceptible.
La jeune fille s’avance au bord du lit, écarte un peu le drap. Elle trempe dans la cuvette chaude la serviette rêche qui attendait sur la table de nuit, soulève la chemise grège et pose le linge sur le ventre distendu. Eau fraîche pour le front, eau chaude pour le ventre. Elle fait de son mieux : le médecin viendra, ce soir, accompagné du pasteur, peut-être. La mort qui semble s’inviter dans la maison est bien silencieuse. La jeune fille envoyée par la matrone pensait que mourir était beaucoup plus bruyant. Pas de pleurs, pas de cris, plus de vie déjà. Elle imaginait que la mort s’accompagnait de larmes et de démonstrations effrayantes.
Ce silence la met mal à l’aise. Même les langes blancs dont dépassent quelques mèches brunes ne semblent pas vivants. Pourtant on lui a dit qu’Élise, la nourrice, allait venir allaiter l’enfant. Elle ne lui a pas prêté attention en entrant, lorsque, pour atteindre le broc posé sur la commode, elle a dû contourner le berceau. C’est comme s’il ne contenait rien. C’est ce qui la trouble le plus. Ici rien ne vit ni ne semble voué à vivre. Elle aimerait bien partir mais elle a reçu l’ordre de veiller jusqu’à l’arrivée du médecin. D’habitude elle garde les chèvres, la chienne qui a mis bas, le petit garçon de la voisine, le temps que la mère s’occupe des bêtes. Veiller le silence et l’obscurité, c’est la première fois, et elle n’aime pas ça du tout... mais elle ne peut désobéir, donc elle fait de son mieux.
Eau chaude, eau froide, pousser et retenir le berceau si l’enfant se mettait à remuer, redescendre doucement l’escalier, servir la soupe à l’homme assis, jeter un œil à l’horloge et espérer qu’enfin les voix des voisins, du médecin, du pasteur viennent rompre ce silence.