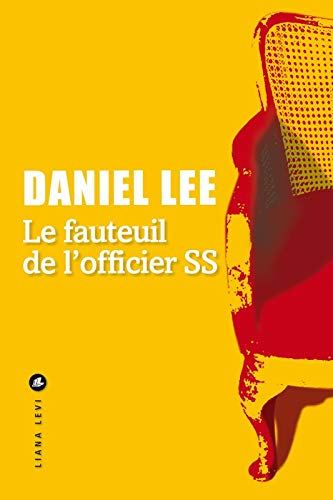Le fauteuil de l'officier SS : Sur les traces d'une vie oubliée
Des documents enfouis dans un fauteuil pendant soixante-dix ans peuvent transformer un historien en détective, a fortiori s’ils sont estampillés de la croix gammée. Le nazisme est un sujet que Daniel Lee connaît bien, pourtant le nom du propriétaire de ces papiers lui est inconnu. Lorsqu’il décide de retracer son itinéraire, il découvre qu’il s’agit d’un officier SS qui, dans les années 1930, a exercé comme juriste à l’hôtel Silber, quartier général de la Gestapo à Stuttgart.
Au fil des recherches, l’univers familial de l’inconnu s’esquisse: la branche paternelle qui a vécu pendant plusieurs générations à La Nouvelle- Orléans dans un climat de haine raciale, les parents qui ont reconstitué à Stuttgart une villa digne de la Louisiane, la femme déclarée «apte» au mariage par la SS et les deux filles qui ignorent tout du passé de leur père. Peu à peu se dessine le parcours de l’officier qui a sillonné la France et ensuite l’Ukraine au sein de la Wehrmacht. Son rôle et sa responsabilité dans la machine criminelle du Troisième Reich se précisent dans cette étonnante chronique du quotidien d’un «nazi ordinaire».
Une quête acharnée de la vérité qui est aussi un puissant révélateur des non-dits et des silences familiaux du narrateur.
Daniel lee est un historien de la Seconde Guerre mondiale, spécialiste de l’histoire des Juifs de France et de l’Afrique du Nord pendant la Shoah. Il est professeur d’histoire contemporaine à l’université Queen Mary de Londres. Après des études à l’université du Sussex, à Sciences-Po Paris et à l’université d’Oxford, il écrit un premier livre, Pétain’s Jewish Children, qui traite du sort de la jeunesse juive sous le régime de Vichy.
La presse en parle
L’ombre de la philosophe Hannah Arendt plane sur l’ouvrage de Daniel Lee et son Fauteuil de l’officier SS qui décortique avec minutie non pas la vie d’un homme ordinaire, mais la fabrication d’un nazi ordinaire.
Le JDD
Extrait
Préambule
Pour la plupart des habitants de Stuttgart entamant leur journée de travail ce vendredi 6 mars 1936, le week-end s’annonçait tranquille. L’atmosphère, dans la capitale de l’État de Wurtemberg, avait beaucoup changé par rapport à ce qu’elle avait été quelques semaines plus tôt, pleine d’énergie et d’enthousiasme, durant les Jeux olympiques d’hiver1. Aux dirigeants nazis, ces Jeux avaient offert une première occasion d’afficher devant le monde entier leur spectaculaire réussite économique. L’événement devait aussi faire taire, espérait-on, les rumeurs de répression contre les opposants politiques et les Juifs dans la nouvelle Allemagne d’Hitler. Les visiteurs étrangers s’en allaient pourtant à peine, après la cérémonie de clôture, que les inscriptions antisémites avaient réinvesti l’espace public à la place des décorations festives.
Les cinq juristes en poste à la section IIIc de la police du Wurtemberg n’avaient rien de particulier à attendre, eux non plus, de ce week-end de mars nuageux et maussade. Le soir approchant, comme les machines à écrire et les sonneries des téléphones se taisaient peu à peu, Walter, Wilhelm, Kurt, Rudolf et Robert quittèrent leur bureau du premier étage de l’hôtel Silber, un imposant bâtiment néo-Renaissance proche du Vieux château, au centre de la ville souabe. Mais le week-end devait se révéler tout sauf ordinaire. Le samedi au matin, transgressant clairement les termes du traité de Versailles, Hitler lança une opération spectaculaire – et illégale – de remilitarisation de la Rhénanie. En tant qu’hommes de loi, les cinq de la section IIIc allaient devoir réfléchir à d’éventuelles représailles juridiques contre l’Allemagne, et aux conséquences de cette réoccupation sur les relations diplomatiques multilatérales. Ils auraient donc beaucoup plus à se dire que d’habitude lorsqu’ils se retrouveraient au bureau le lundi.
Le petit groupe soudé qu’ils formaient ensemble travaillait à l’écart des deux cents autres fonctionnaires de l’hôtel Silber2. Ils avaient tous les cinq un peu moins ou un peu plus de trente ans, trois d’entre eux avaient fait leur droit à la prestigieuse université de Tübingen, et, à l’exception de Kurt Diebitsch, ils n’avaient rejoint la section IIIc que depuis l’accession au pouvoir des nazis quelques années auparavant. Ils se fréquentaient, avec leurs familles, en dehors du cadre professionnel rigide de l’hôtel Silber. En février ils avaient fêté les noces de Robert Griesinger, le plus jeune et le moins gradé d’entre eux, un grand garçon aux cheveux bruns, toujours bien habillé, qui avait enfin épousé sa dulcinée, originaire de Hambourg, après des fiançailles un peu trop prolongées.
La section IIIc de la police était un acteur déterminant, depuis le printemps 1933, de l’enracinement et du développement du nazisme à Stuttgart. De fait, il ne s’agissait pas d’une force de police conventionnelle. L’hôtel Silber abritait le quartier général de la police politique de l’État de Wurtemberg, déjà plus connue par un acronyme familier: Gestapo. Sous le règne des nazis, la police politique du Wurtemberg occupait la totalité du bâtiment, soit cent vingt chambres sur six étages. Au sous-sol se trouvaient les salles de tortures tristement célèbres de la Gestapo. Aujourd’hui encore, certains Stuttgartois âgés, marqués par les récits terrifiants qu’ils ont entendus jadis sur ce qui se passait dans ce sous-sol, évitent d’emprunter la Dorotheenstrasse. C’était Walter Stahlecker, un homme mince, aux lunettes rondes à monture d’acier, aux cheveux clairsemés mais soigneusement peignés en arrière, qui dirigeait la police politique du Wurtemberg. Plus tard il commandera l’Einsatzgruppe A, une unité d’extermination mobile responsable pendant la guerre de l’assassinat de centaines de milliers de Juifs dans les pays baltes. Son adjoint, Wilhelm Harster, un blond plus corpulent, servira un jour aux Pays-Bas comme chef de la police de sûreté et du Sicherheitsdienst (SD) – le service de renseignement et de sécurité de la Schutzstaffel (SS) –, où il jouera un rôle clé dans la déportation de plus de cent mille Juifs. Pendant que Stahlecker marchera à travers la Baltique et que Harster pourchassera les Juifs aux Pays-Bas, Rudolf Bilfinger, qui, en 1936 à Stuttgart, n’était encore qu’administrateur subalterne, restera en Allemagne pour devenir responsable du groupe Organisation et Droit à l’Office central de la sécurité du Reich (RSHA). Proche d’Adolf Eichmann, Bilfinger sera aussi, en 1942, l’un des architectes juridiques de la Solution finale3. Plus tard il sera nommé chef de la police de sûreté et du SD à Toulouse.
Si les noms de ces trois hommes apparaissent dans les études sur la Seconde Guerre mondiale, on ne peut en dire autant ni de Kurt Diebitsch, le quatrième juriste, qui sera tué pendant l’invasion de l’URSS en 1941, ni de Robert Griesinger, le jeune époux et cinquième membre de la section IIIc, qui finira la guerre comme expert juridique dans un ministère de Prague occupée.
Le nazisme a eu un impact dévastateur sur le monde et, trois quarts de siècle plus tard, il continue de nous fasciner. Mais la plupart d’entre nous ne connaissons les noms que d’une poignée de nazis – ceux de l’entourage d’Hitler. Que savons-nous d’hommes comme Diebitsch et Griesinger, qui jusqu’à aujourd’hui ont échappé à l’attention des cinéastes, des documentaristes et des écrivains? Ces nazis de second plan sont doublement invisibles: ignorés par les historiens, oubliés ou même délibérément refoulés dans la mémoire de leurs descendants encore en vie. La tâche ardue consistant à identifier certains personnages mineurs du régime, puis, dans un second temps, à comprendre comment ils ont vécu, les sentiments qui les ont animés, est importante pour ce qu’elle nous révèle sur le consentement et le conformisme sous l’empire de la croix gammée. Faire resurgir ces voix perdues du passé nous permet de poser de nouvelles questions sur la responsabilité, la faute et la manipulation. Elles nous ouvrent des perspectives auparavant négligées sur la montée du nazisme et sur les rouages de l’appareil nazi.