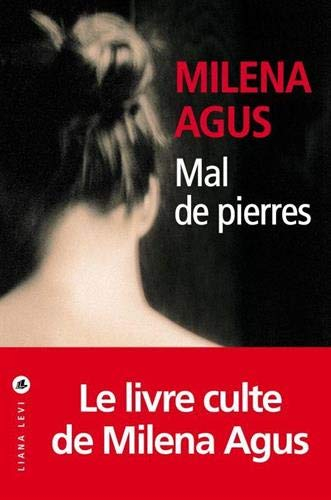Mal de pierres
En quête de l'amour idéal, l'héroïne tarde à trouver un mari. À trente ans, déjà considérée comme une vieille fille dans une Sardaigne qui connaît les affres de la Seconde Guerre mondiale, elle finit par épouser un homme taciturne, plus âgé qu'elle, parce que sa famille le lui impose. L'amour n'est pas au rendez-vous. Elle le rencontrera beaucoup plus tard, lorsqu'elle ira sur le Continent faire une cure thermale pour soigner son « mal de pierres », des calculs rénaux.
Un rescapé de la guerre, qui souffre du même mal qu'elle, aura raison de son « mal d'amour ». C'est à sa petite-fille qu'elle racontera quelques décennies plus tard ses émotions, ses cheminements, tout en laissant des zones d'ombre. Mais quelle est au juste la vérité ? Elle ne se recomposera que beaucoup plus tard, de façon inattendue, lorsque la dernière pièce du puzzle tombera entre les mains de la narratrice.
Milena agus enthousiasme le public français en 2007 avec Mal de pierres. Le succès se propage en Italie et lui confère la notoriété dans la trentaine de pays où elle est aujourd’hui traduite. Au fil des textes, elle poursuit sa route d’écrivain, singulière et libre. De ses romans elle dit : « C’est ainsi que je vois la vie, misérable et merveilleuse... » Elle vit et enseigne à Cagliari, en Sardaigne, où elle est née.
La presse en parle
Un petit bijou de roman, poli comme une pierre précieuse et délicieux, pour ne pas dire entêtant, comme certains gâteaux sardes, tout miel et tout anis.
Extrait
Grand-mère connut le Rescapé à l’automne 1950. C’était la première fois qu’elle quittait Cagliari pour aller sur le Continent. Elle approchait des quarante ans sans enfants, car son mali de is perdas, le mal de pierres, avait interrompu toutes ses grossesses. On l’avait donc envoyée en cure thermale, dans son manteau droit et ses bottines à lacets, munie de la valise avec laquelle son mari, fuyant les bombardements, était arrivé dans leur village.
Elle s’était mariée sur le tard, en juin 1943, après les bombardements américains sur Cagliari, à une époque où une femme pas encore casée à trente ans était déjà presque vieille fille. Non qu’elle fût laide, ou qu’elle manquât de soupirants, au contraire. Mais un moment venait où les prétendants espaçaient leurs visites, puis disparaissaient de la circulation, toujours avant d’avoir demandé officiellement sa main à mon arrière-grand-père. Chère Mademoiselle, des raisons de force majeure m’empêchent ce mercredi, ainsi que le prochain, de fai visita a fustetti , comme c’était mon vœu le plus cher, mais hélas irréalisable.
Ma grand-mère attendait alors le troisième mercredi, mais chaque fois se présentait une pipiedda, une fillette, qui lui apportait une lettre repoussant encore, et puis, plus rien.
Mon arrière-grand-père et ses sœurs l’aimaient bien comme ça, un peu vieille fille, contrairement à mon arrière-grand-mère qui la traitait comme si elle n’était pas de son sang et, disait-elle, elle avait ses raisons.
Le dimanche, quand les autres filles allaient à la messe ou se promenaient sur la grand-route au bras de leurs fiancés, grand-mère relevait en chignon ses cheveux, toujours noirs et abondants quand j’étais petite et elle déjà vieille, alors imaginez dans sa jeunesse, et elle se rendait à l’église demander à Dieu pourquoi, pourquoi il poussait l’injustice jusqu’à lui refuser de connaître l’amour, qui est la chose la plus belle, la seule qui vaille la peine qu’on vive une vie où on est debout à quatre heures pour s’occuper de la maison, puis on travaille aux champs, puis on va à un cours de broderie suprêmement ennuyeux, puis on rapporte l’eau potable de la fontaine, la cruche sur la tête ; sans compter qu’une nuit sur dix, il faut rester debout pour faire le pain, et aussi tirer l’eau du puits et nourrir les poules. Alors, si Dieu ne voulait pas lui révéler l’amour, Il n’avait qu’à la faire mourir d’une façon ou d’une autre. En confession, le prêtre disait que ces pensées constituaient un grave péché et que le monde offrait bien d’autres choses, mais pour grand-mère, elles étaient sans intérêt.
Un jour, mon arrière-grand-mère attendit sa fille armée de la zironia, un nerf de bœuf, dont elle la frappa si fort qu’elle en eut des blessures jusque sur la tête et une fièvre de cheval. Mon aïeule avait appris, par des rumeurs qui couraient le village, que si les prétendants de grand-mère se défilaient, c’était parce qu’elle leur écrivait des poèmes enflammés qui contenaient même des allusions cochonnes et que sa fille salissait non seulement son honneur, mais celui de toute la famille. Elle la frappait à tour de bras en vociférant : « Dimonia ! dimonia ! » et elle maudissait le jour où ils l’avaient envoyée à l’école apprendre à écrire.