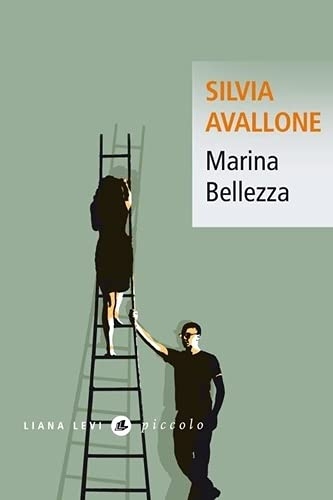Marina Bellezza
L’avenir est à réinventer dans cette vallée coincée entre des montagnes de granit. Une départementale bordée par les carcasses des filatures abandonnées mené à des villages silencieux, un no man’s land aux confins de l’Italie. Pour Marina, vingt-deux ans, un corps et une voix de déesse, le futur se joue résolument ailleurs. Sur les plateaux de télé qui métamorphosent les starlettes de province en divas. Pour Andrea, fils d’une famille de notables, l’Eldorado est à portée de main, dans la ferme d’alpage de son grand-père. Mais les rêves de ces deux héros contemporains se cognent à l’amour impossible qui les unit depuis l’adolescence.
Incroyablement douée pour cerner les failles de notre époque et les doutes de sa génération, Silvia Avallone compose un deuxième roman fougueux autour des thèmes de l’enracinement et de l’abandon.
La presse en parle
Un livre drôle, plein de vie et de rage qui décrit avec tendresse et férocité les doutes et les rêves de sa génération.
France Inter
Extrait
Une clarté diffuse brillait quelque part au milieu des bois, à une dizaine de kilomètres de la départementale 100 encastrée entre deux colossales montagnes noires. Seul signe qu’une forme de vie habitait encore cette vallée, à la frontière nue et oubliée de la province.
Elle apparaissait soudain derrière le pare-brise, comme un appât qui luit par intermittence dans les abysses. Au virage suivant, ils la perdaient de vue.
Ils ralentirent à un croisement au milieu de rien, devant les ruines d’un restaurant. Deux fenêtres barricadées et un panneau sur lequel s’effaçaient l’inscription Menu à prix fixe, et d’autres mots encore illisibles. L’un d’eux se rappela y avoir fêté sa première communion. Vingt ans après, il n’en restait plus que le toit et les poutrelles. Vingt ans, et tout était fini.
De nouveau, ils accélérèrent. Il n’y avait plus d’éclairage sur cette portion de la route, plus de grillage pour les protéger des rochers en surplomb, menaçants. Les phares surprenaient des escarpements infestés de ronces, parfois une construction à demi écroulée. Même les panneaux routiers disparaissaient, là-haut, dans la nuit vide.
Ils étaient les seuls à rouler sur cette départementale, entre cul-de-sac et abandon. À grimper le long de ces pentes à bord d’une vieille Volvo break, enfiler les uns après les autres ces tournants qu’ils connaissaient par cœur depuis toujours. Les grands arbres, à mesure que la route montait, prenaient des allures de spectres. Les parois de la vallée se refermaient en précipice au-dessus du torrent, et par les vitres baissées n’entrait que le roulement usant et monotone de l’eau.
La lumière reparut, faible, en partie cachée par la crête d’une montagne. De nouveau ils la regardèrent, sans parler.
Ils atteignirent Andorno. Des feux orange clignaient à intervalles réguliers mais la Volvo filait à quatre-vingt-dix sans respecter les stops ni les priorités.
Après le cimetière, et ce qu’il restait du petit terrain de foot où ils avaient grandi, la silhouette délabrée du Bar Sirena les attendait, enseigne éteinte. Ils s’arrêtèrent. Descendirent de voiture. L’un était grand, l’autre râblé, et le troisième avait les yeux plus noirs que le pétrole. Ils s’approchèrent de la porte : à l’intérieur, pas un bruit. Ils secouèrent quand même la poignée.
« Fermé. »
Sebastiano, le grand, restait planté devant l’entrée. Il continua de fixer la porte d’un œil mauvais, y lança un coup de pied, puis un autre. Dehors les tables étaient empilées et attachées par des cordes, comme si quelqu’un pouvait avoir l’idée de les voler. Par terre, des paquets de cigarettes vides roulés en boule.
Luca, celui qui était râblé, fit le tour du bâtiment pour vérifier.
« Rien, c’est vraiment fermé.
– On s’en va », dit Andrea.
Lui, il était calme. Ses yeux durs plongés dans l’obscurité.
«Où ça?»
La question fut aussitôt avalée par la nuit. Sebastiano était nerveux et regardait Andrea d’un air de défi, attendant sa réponse.
Luca sortit son portable et commença à faire défiler son répertoire.
« J’en sais rien », dit Andrea.
Il arrangea son col de chemise, alluma une Lucky.
La ville, ce n’était pas son truc, les discothèques du coin l’avaient toujours mis mal à l’aise. Il préférait ces montagnes désertées depuis des décennies, là au moins il n’était pas un étranger.
Il se retourna pour regarder là-haut, entre la Valle Cervo et la Valle Mosso, cette lumière qui était toujours là, voilée par l’humidité de la nuit. Il l’indiqua aux deux autres d’un signe de tête. Ils levèrent les yeux, hésitants, puis remontèrent en voiture.
Sebastiano démarra, ils retraversèrent Andorno mais prirent une autre route, la départementale 105 par San Giuseppe di Casto. La lueur maintenant était plus visible. Et semblait plus proche. Sans se concerter, ils décidèrent de la suivre. Ce n’était peut-être qu’un incendie, mais ils décidèrent de la suivre.
À San Giuseppe, il y avait un marchand de journaux, une épicerie, une église. Bientôt tout disparut dans le rétroviseur. Ils étaient tous comme ça par ici, les villages: abandonnés, volets fermés, enseignes éteintes. Eux, pourtant, ils n’avaient pas eu envie de partir, au contraire: leurs sentiments, leur sens de l’orientation, tout leur était dicté par ces routes, par ces montagnes.
Certains soirs comme celui-là, ils se parlaient à peine. Andrea, la tempe contre la portière, regardait dehors. Sebastiano conduisait et savourait sa liberté reconquise, après neuf mois d’assignation à domicile. Il se demanda un instant ce que son fils penserait de lui, plus tard, quand il serait grand.
Lieu-dit Golzio. L’autoradio ne marchait pas, et ils continuaient à ne rien dire. À force de fréquenter les rochers et les bois, ils avaient pris la manie du silence. Luca faisait défiler son répertoire à la recherche d’une fille à appeler – une copine, n’importe laquelle – sans arriver à se décider.
« J’aimerais bien savoir où on va », dit-il.
Personne ne répondit. Les bois formaient des masses obscures où les branches s’entremêlaient. Sebastiano continuait de se demander si Mathias lui donnerait raison, à lui, ou à sa conne de mère. Andrea pensait à son père, se persuadant qu’il était suffisamment adulte pour l’affronter directement. Tous trois fixaient les pentes ensevelies dans la nuit, cette terre qui n’appartenait à personne. Des petits villages agrippés aux rochers. Cent, deux cents habitants.
Ils continuaient à suivre cette lueur là-haut, qui n’était la promesse de rien, et si faible à présent qu’on aurait dit la flamme d’une chandelle.
Et ils continuaient à ruminer, grimpant le long de cette route déserte pour se laisser happer par des gouffres de sapins et de broussailles, se demandant comment faire pour trouver un billard, un bar ouvert, pour que quelque chose, enfin, arrive dans ce silence.
Puis, en une fraction de seconde, alors que Sebastiano se tournait vers l’arrière pour demander à Andrea de lui allumer une cigarette et que Luca se penchait pour ramasser le briquet qu’Andrea avait laissé tomber, dans cette fraction de seconde exactement, ce quelque chose arriva.
Cela jaillit d’un buisson à une vitesse folle et se matérialisa au milieu de la route.
Et c’était vivant. Énorme. Ça ne bougeait pas. Ça restait là, comme pétrifié par une force obscure.
Deux cercles jaunes s’allumèrent dans la nuit, réfractant la lumière des phares, sauf qu’ils n’eurent pas le temps de les voir. Et avant qu’ils puissent comprendre, avant que Sebastiano se retourne enfin et d’instinct écrase son pied sur le frein, la Volvo le prit de plein fouet.
Ce fut terrible. Le choc féroce d’un corps fait de tôles contre un autre plus dur encore. Les phares s’éteignirent en même temps que le moteur. Luca se retrouva le nez sur le pare-brise, le cœur battant la chamade, Andrea bascula entre les sièges avant. Le silence était total, comme le noir d’encre où ils étaient plongés. Sebastiano avait toujours les mains serrées sur le volant.
Il y eut un instant de panique, ils respiraient tous les trois par à-coups, sans rien pouvoir faire d’autre, les yeux écarquillés. Puis ils comprirent que la Volvo était morte, au beau milieu de la route.
«Putain de merde!» cria Sebastiano. Et il chercha les autres du regard.
Ils avaient les joues brûlantes, leur cœur cognait si fort que chacun croyait entendre celui de l’autre. Ils étaient vivants.
« C’était quoi ? demanda Luca.
– Quoi que ce soit, dit Andrea, c’est toujours là, dehors. »
Cette simple constatation suffit à les clouer sur leurs sièges.
« Et si on avait tué quelqu’un ? – Quelqu’un?»
Ils restèrent muets, paralysés à l’idée des conséquences.
Puis Sebastiano se secoua, tapa du poing sur le volant.
« Putain mais qu’est-ce que vous racontez ? Je veux pas retourner en taule.» Il voulut redémarrer. «Ça part pas. »
Il se courba sur le volant pour regarder devant, à travers la vitre salie de traces de pluie et de moucherons écrasés. Il vit que le capot était tout tordu. Alors, furieux, il ouvrit la portière.
Les autres descendirent aussi. La nuit s’agitait dans le vent, entre les pentes, les bois, comme une créature vivante. Le côté gauche du capot semblait recroquevillé sur lui-même, irrécupérable. Un des phares n’existait plus. Et aucune autre lumière n’arrivait dans ces montagnes que celle, infime, de la lune.
Ils allèrent voir, espérant ne rien trouver. Mais une forme était couchée sur l’asphalte, à une dizaine de mètres, sur la ligne continue séparant la chaussée, et elle bougeait.
Sebastiano s’approcha, pendant que les autres restaient à distance. Il se courba, et fit un bond en arrière.
« Merde !
– C’est quoi ?»
La route était vide, les portables ne captaient pas.
« Allume les phares, vite ! » hurla Sebastiano, bouleversé.
Andrea demeurait silencieux, glacé par cette scène nocturne qui n’avait aucun sens, et qui pourtant était réelle.
Sebastiano continuait à se pencher puis à reculer, comme s’il ne trouvait pas le courage de regarder.
Luca tourna la clé de contact, les mains moites, mais le moteur ne partait pas.
Andrea rejoignit Sebastiano près de la forme inerte et sombre qui gisait là, au milieu de la route secondaire. Il s’accroupit pour l’examiner, comprendre de quoi il s’agissait, mais à cet instant précis Luca put redémarrer, et le phare droit s’alluma d’un coup, les aveuglant.
Il y a des moments où tu ne penses rien, tu ne comprends rien et tu n’es personne.
Il y a des moments, à vingt-sept ans, où tu ne connais qu’une seule chose, la plus importante, la plus vraie de toutes. La peur.
Quand Andrea rouvrit les yeux, ce qu’il vit par terre, c’était une masse effroyable, sanglante et brune. Et quand il perdit l’équilibre, et involontairement la heurta du pied, elle poussa un cri déchirant, à la fois humain et inhumain, et se mit à trembler.
« C’est vivant... »