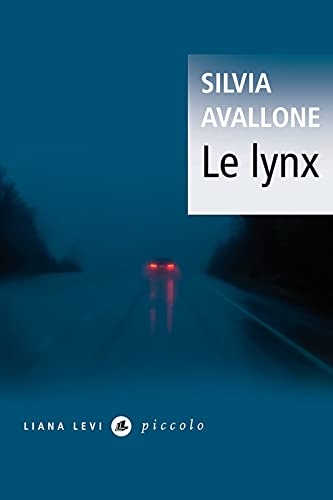Le lynx
Piero aime les belles voitures. Volées de préférence. L’espace d’un instant, dérober lui permet de fuir un quotidien morne et lui confère l’agilité et la puissance d’un lynx. Une nuit de brouillard, quelque part dans la plaine du Pô, il arrête son Alfa Romeo rutilante sur une aire de repos, entre dans un restoroute et s’apprête à braquer la caisse lorsqu’il tombe sur un adolescent paumé dont l’assurance et l’étrange beauté le foudroient… Une rencontre improbable qui changera le cours de sa vie.
La presse en parle
Silvia Avallone magnifie, dans une langue qui claque, le monde des laissés-pour-compte et leur lutte contre la résignation.
Le Nouvel Observateur
Extrait
Ils se rencontrèrent pour la première fois dans un restoroute, en pleine nuit. Une de ces nuits, toutes pareilles, qui flottent lourdes comme du pétrole sur la lande silencieuse entre Novara et Vercelli.
Une pancarte verte émergea, après des kilomètres de néant. D’instinct, Piero mit le clignotant et commença à ralentir. Presque une heure du matin. L’obscurité dense découpée par les phares peinait à s’ouvrir. Et dans le fleuve noir de l’autoroute, il n’y avait pas d’autres lumières que les siennes, solitaires comme deux étoiles.
Il n’était pas pressé de rentrer. Le brouillard noyait un paysage fantôme que Piero connaissait dans ses moindres recoins. Une baraque, des rizières. Une autre baraque, d’autres rizières.
Il déboîta vers l’aire de repos Biandrate-Vicolungo, sur l’A4, direction Turin. Les haut-parleurs de la radio diffusaient un vieux succès de Toto Cutugno qui lui rappelait son enfance, son père, une Marlboro rouge au coin des lèvres et une bague en or géante au petit doigt de la main gauche. Son père en 1983, la dernière fois qu’il l’avait vu.
Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia...
Le parking du restoroute, semi-désert, était éclairé comme les cours des prisons la nuit.
Il roulait dans une Alfa Romeo Gran Turismo, rouge, volée. Il éteignit la radio, détacha sa ceinture. Il aimait les parkings d’autoroute à cette heure de la nuit, des atolls de lumière flottant dans le vide. Il aimait les poids lourds garés en épi, rideaux tirés sur les cabines. Les pancartes, les pompes à essence : tout nageait dans le flou, telles des méduses dans l’eau.
Il aimait ce genre d’endroit parce qu’il s’y sentait loin de chez lui.
Il gara l’Alfa Romeo quasiment neuve, entièrement repeinte, devant l’enseigne lumineuse. Restoroute. Deux mots en un. Elle brillait comme une promesse. Il faisait un froid de canard, sûrement moins deux ou moins trois. Piero descendit en manches de chemise, sa croix bien en vue sur son torse. Parce qu’il croyait en Jésus-Christ, lui, et à la Vierge. Mais pas en Dieu.
Dès l’entrée, une bouffée de chaleur écœurante le saisit et il fut frappé par la silhouette fatiguée de la caissière, dans la cinquantaine. La vue de tous ces rayons remplis de chips, de bonbons, de dentifrices et d’Arbres Magiques le mit aussitôt en joie, comme une dose d’amphètes.
Piero aimait l’abondance, la voir étinceler, constater sa présence. Il était heureux que des endroits comme celui-là existent, perdus et sans défense, mais bourrés à craquer de choses faciles à attraper et emporter, à glisser dans sa poche d’un geste vif et précis. Les mains de Piero étaient comme des scalpels. Grandes, calleuses, terribles. Sa carrière avait commencé à l’école primaire, dans les supermarchés. Piero connaissait la fatigue du visage absent des caissières, dissimulée sous le maquillage. Ensuite, il était passé aux cambriolages.
C’était un bel homme, grand, propre, parfumé. La quinquagénaire en uniforme rouge du restoroute le regarda, les yeux bouffis de sommeil, un éclair de peur dans le regard.
Sur une inspiration, il s’approcha du comptoir. L’envie lui était venue tout à coup d’un Negroni, et d’un de ces sandwiches empaquetés depuis deux jours. Les caméras de surveillance, il s’en foutait. C’était rare qu’il se mette un bas noir sur le visage. Il préférait agir à découvert, pour marquer les mémoires.
« Un Negroni et un sandwich. Merci.
– On ne sert plus d’alcool après vingt-deux heures... désolée. »
Piero la regarda d’un air malicieux.
« Même pas une petite exception ? »
Elle secoua la tête tout en nettoyant le comptoir avec une éponge.
«Alors je prendrai un Red Bull avec des glaçons... »
Il croyait qu’ils étaient seuls, la caissière aux nichons en berne et lui. Les coups improvisés, c’était ce qui lui réussissait le mieux. Et il n’avait que dix euros en poche, pas plus.
« Je vous encaisse d’abord. S’il vous plaît. »
Piero tira de son portefeuille son unique billet tout froissé. Calme, rasé de frais, les joues qui fleuraient bon l’après-rasage. Impeccable, même à une heure et quart du matin. Pantalon milleraies, chemise blanche sans un faux pli. Chaussures étincelantes.
Il croyait qu’ils étaient seuls. Et il n’était pas pressé de rentrer. Avec l’euro qu’elle lui rendit, il prit un ticket de grattage. Il avait tout le temps du monde. Il pouvait tranquillement boire, manger, retourner à sa voiture, prendre son arme.
La femme n’arrêtait pas de le fixer. Sous ses cils plâtrés au Rimmel, feignant de rincer des tasses à café, elle le tenait à l’œil. Et lui, naturellement, s’en aperçut. Son alphabet préféré: celui des gestes, de l’adrénaline à fleur de peau, et la peur de la caissière qui faisait monter la pression. Elles essaient d’être naturelles, mais elles n’y arrivent jamais. Cette vie de merde qu’elles ont. Huit heures par jour à taper des chiffres sur la caisse, à la faire tinter. Pour mille euros par mois, un mari qui s’endort sans les attendre, les enfants qui grandissent tant bien que mal. Piero regrettait pour elles, mais elles avaient choisi. Lui, c’était pas son genre de se faire baiser.
Il sirota son Red Bull et se mit à gratter avec sa clé. La vie, tu pouvais la jouer de plusieurs manières, et le grattage en était une. Piero ne savait pas trop ce que c’était, le capitalisme, mais ça lui plaisait bien. Qu’on fabrique tous ces trucs sur le dos de ces pauvres couillons qui se tuaient à la tâche, dans les usines et sur les chantiers; et que grâce à ça des types se la coulent douce sur des yachts amarrés à Portofino ou à Monte-Carlo, se pavanent en Lamborghini et mettent dans leur lit des ribambelles de filles superbes, ça lui plaisait bien. Un jour ou l’autre, il aurait un coup de chance et lui aussi mettrait la main sur toutes ces merveilles.
Il avait trente-neuf ans déjà, mais il y croyait encore.