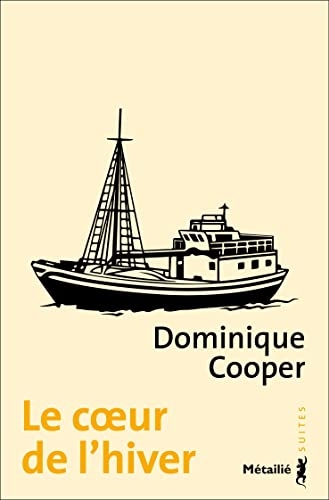Le Coeur de l'hiver
Sur la côte ouest de l’Écosse, Alasdair Mor exploite la petite ferme familiale, seul après la mort de son père et le départ pour la ville de son frère. Il vit de la pêche au homard. Il aime profondément la nature sauvage et grandiose qui l’entoure. Mais un couple s’installe dans les environs, et le vol et le mal font irruption dans sa vie. Cela entraînera un affrontement et une poursuite hallucinante à travers les collines sauvages.
Au-delà des personnages austères et attachants, les véritables héros du livre sont l’océan, le vent glacial et la lande inhabitée. Les descriptions de la mer ou du passage des saisons vers un inévitable « cœur de l’hiver » sont inoubliables.
Ce texte poétique et lyrique aux accents steinbeckiens est écrit dans une langue magnifique.
Extrait
1
Le soleil. Et ce qui plus tôt ce jour d’automne avait été une explosion de chaleur immense et illimitée était à présent une puissance domptée recouvrant d’une mince couche de cuivre les plaines de l’Atlantique. La lumière scintillante ne cessait de progresser sur la mer, kilomètre après kilomètre, atteignait les rochers et les récifs de la côte, se glissait sur les terrasses de la rive et les traversait, grimpait avec force les cinquante derniers mètres de la falaise où l’herbe et les bouleaux nains avaient été écrasés contre la surface de la terre et puis elle plongeait dans les collines tapissées de bruyère et de sphaigne qui s’étendaient en terrasses et en pentes douces remontant jusque dans le ciel bleu au-dessus de l’île. Une brise légère transportait l’odeur du myrte bâtard et de la bruyère, de la vie marine. Et ainsi tout au long de la côte du grand promontoire dénudé, de sorte que toute la masse rocheuse qui se dressait, avec son extrémité aplatie et arrondie, au milieu de l’océan, adoucie par les dernières semaines du long été qui précédait l’inévitable hiver, avec ses vents et ses pluies, tremblait de chaleur et de vie.
Alasdair Mór ressentait lui aussi le soleil et tremblait en marchant. Comme le poids de ses gros souliers cloutés, en écrasant la sphaigne, faisait remonter toute l’humidité jaune, verte et brune, il se dirigea vers un sol plus sec, du côté de la mer. Quand il eut trouvé un terrain plus ferme, son grand corps reprit sa marche régulière et traînante. Il avançait comme un ours sur ses pattes postérieures, à petits pas, épaules tombantes un peu en avant du reste de son corps, avant-bras pendants telles des pattes antérieures ; poitrine, taille et hanches roulant maladroitement. En grimpant sur une butte couverte d’une bruyère qui lui montait aux genoux, il sentit ses cuisses se tendre sous la laine grossière du pantalon. Son épais tricot en laine huilée gris-vert, et son gilet en cuir taché et déchiré, tous les deux datant de plusieurs saisons, s’ingéniaient à le gêner tandis qu’il grimpait. Il grogna deux fois afin de donner voix à son effort puis, après une dernière enjambée, il se retrouva sur un monticule lisse et vert au bord de la falaise. Il s’arrêta un instant. Il remit en place sa casquette graisseuse, une fois, deux fois, se gratta la nuque puis, ayant enlevé sa casquette, il exposa son crâne au soleil.
Son visage était semblable à son corps, semblable à la colline derrière lui. Rugueux, battu par les intempéries, une ossature lourde. Un nez et des oreilles de bonne taille, des lèvres pleines, généreuses, comme la chair des pinces d’un crabe adulte. Et un peu partout, sans dessin particulier, poussaient de petites touffes de poils. Il y avait les poils sur ses joues non rasées, tel le regain dans une prairie à l’automne, mais aussi quelques longs poils, par un ou par deux, par touffes, n’ayant jamais connu la lame, qui poussaient sur les lobes de ses oreilles, au bout de son nez, dans ses narines, sur les arêtes épaisses de ses pommettes. Ses sourcils s’emmêlaient en un grand bosquet de pins au-dessus de son nez. Ses cheveux étaient gras et épais, aussi noirs qu’un cormarin, sans la moindre trace de gris malgré ses quarante-cinq ans. Ils roulaient et bouclaient en une houle froide et désordonnée, aussi fibreux et drus que des racines de bruyère sur son crâne épais, marqués seulement par le bord de sa casquette.
Son visage était déformé — ses yeux plissés, sa bouche tendue — comme si la lumière était trop forte. Mais ce n’était pas le cas. C’était ainsi qu’il figeait son visage en une grimace quand il réfléchissait. Et à présent, le soleil du début d’octobre encore bas à l’horizon, il regardait la mer, plus ou moins vers le nord, là où la houle se soulevait avant de retomber sur les rochers de Maisgeir. Le temps allait rester au beau et il réfléchissait. Se disait qu’avec ce calme il pourrait poser quelques casiers à l’extrémité sud du récif, là où il y avait le moins de houle. Il se rappelait la première fois où son père l’avait emmené à Maisgeir. Une journée semblable. Il avait environ neuf ans. Il voyait son père à la proue de leur barque, lui-même aux rames et s’efforçant d’empêcher la barque de dériver. Son père, un homme de grande taille, un talon coincé sous le plat-bord pour garder l’équilibre, halant la ligne main sur main, les trois casiers apparaissant lentement à la surface, l’un après l’autre, son propre enchantement et la satisfaction de son père devant les huit homards prisonniers à l’intérieur. Lui, oubliant ses premières responsabilités d’homme, se leva d’un bond pour examiner les créatures, et son père, dans un moment de colère et de peur, aboya pour qu’il reprenne sa place. Jamais les eaux de Maisgeir ne devaient être prises à la légère. Et comment il avait rougi et accepté cette réprimande légitime et comment son père, plus tard, avait retrouvé son sourire, et puis rentrer à la rame dans la lumière qui faiblissait, tous deux silencieux mais unis par quelque chose qu’ils n’avaient pas besoin d’exprimer.
Toute sa vie, son père avait pêché le homard et Alasdair, dès l’âge de treize ans, avait exercé le même métier. Avant cela il avait dû aller à l’école du village, à quelque quinze kilomètres de là, jusqu’au jour où son père avait fait une chute et s’était abîmé le dos. Alors, Mr Morrison, le maître d’école venu d’Aberdeen, l’avait pris à part un matin de printemps et lui avait dit que si son père avait besoin d’aide pour les homards il pouvait cesser de venir à l’école. Alasdair avait attendu en silence, sans réagir, tandis que Mr Morrison lui expliquait qu’il continuerait à mettre son nom sur le registre pendant les quelques mois qui restaient avant que la loi l’autorise à quitter l’école. Il avait alors simplement hoché la tête, était rentré chez lui et n’avait jamais remis les pieds dans la salle de classe. Être ainsi libéré de l’école où Ina Maclean, Jennie MacFadyen et Wee Jamie l’avaient torturé à force de moqueries en raison de la lenteur de son esprit lui avait donné une force supplémentaire lorsqu’il apprit à manier les lourdes rames et à remonter les casiers submergés et pesants. Quatre ans plus tard, quand son père fut plus ou moins cloué au lit par la douleur, son jeune frère David commença à l’accompagner sur la barque. Pendant trois années encore les deux fils avaient partagé leur temps entre la pêche et les soins à leur père invalide. Leur mère était morte en donnant naissance à David de nombreuses années plus tôt et il y avait peu de gens à proximité susceptibles de leur prêter main forte.
Puis, brutalement, par un matin lumineux de mai, alors qu’Alasdair était remonté du rivage pour demander à son père s’il voulait qu’il l’installe au soleil, il avait trouvé son père étendu là, la bouche ouverte toute grande comme au milieu d’un bâillement, le regard fixé sur lui, qui se tenait dans l’encadrement de la porte. Alasdair était resté un moment sans comprendre et puis il avait soudainement réalisé ce qui se passait avec une sensation de deuil engourdi et il avait appelé David. Et ensemble ils l’avaient arrangé et lavé avant d’entreprendre une exceptionnelle excursion jusqu’à la petite ville pour rencontrer le ministre du culte puis Duncan la Mailloche, l’homme pourrait leur fabriquer un cercueil grossier. Et le lendemain ils s’étaient rendus à pied à Achateny pour emprunter un cheval et une carriole et étaient allés chercher le grand cercueil de bois vert qui résonnait. Mais Duncan, qui n’avait pas vu leur père depuis au moins trois étés, ne savait pas à quel point l’invalidité l’avait fait maigrir et rétrécir, de sorte qu’au moment où Alasdair et David avaient installé le corps, ils s’étaient rendu compte que le cercueil était bien trop grand. Lui, leur immense père, qui n’avait peur de rien, était ratatiné et perdu dans la boîte. Ils avaient donc tassé de vieux sacs à poissons autour de lui de peur qu’il soit secoué pendant le trajet jusqu’à la ville. Et ils eurent l’impression qu’il valait mieux que l’étrange odeur de chair froide soit couverte par les odeurs bien connues de la roussette et du maquereau. Ensuite tous deux se rasèrent et lavèrent leurs visages et leurs mains dans le ruisseau et, une fois le cercueil chargé sur la carriole, ils se rendirent au temple, assis côte à côte dans un silence timide sur le banc du cocher. Un an plus tard David avait dit adieu puis avait disparu de l’autre côté de la colline, en quête d’une vie nouvelle.
Il y avait eu vingt-quatre ans de cela en janvier dernier.